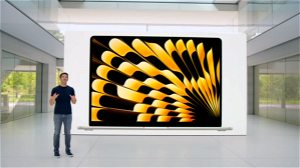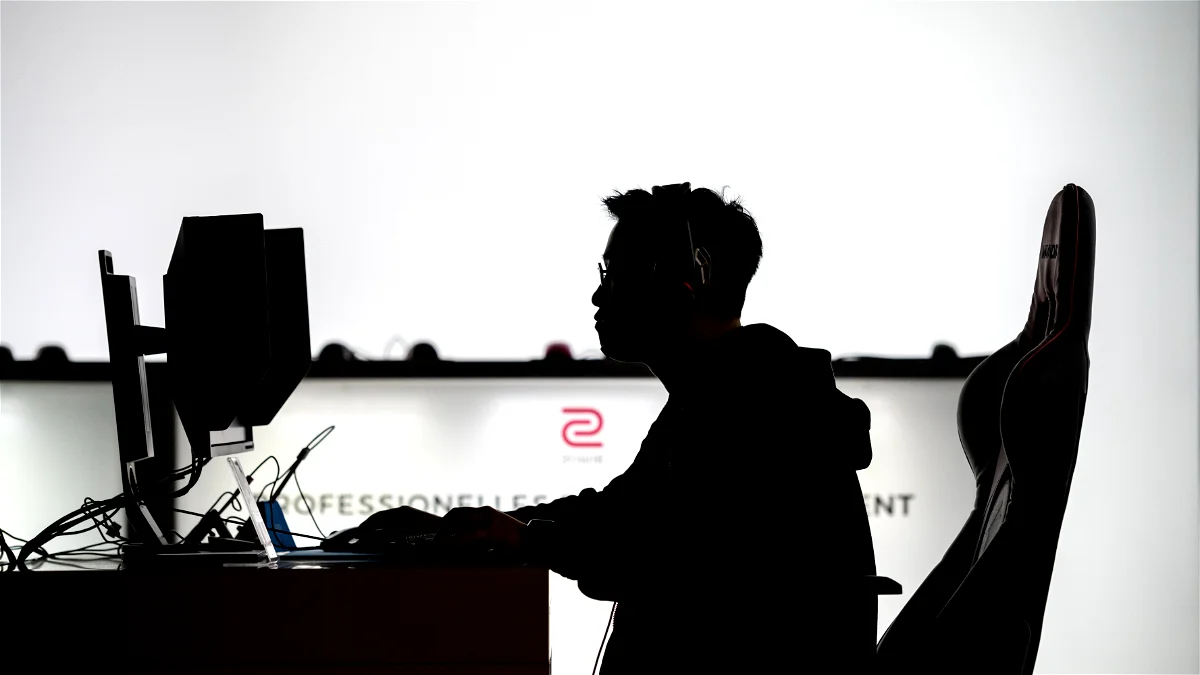Des trains toujours en marche quoiqu’il arrive? C’est la volonté du gouvernement fédéral qui a finalement obtenu le service minimum: il y aura un minimum de trains sur les voies en période de grève. Une lutte de quatre années qui ne réjouit, bien sûr, pas les syndicats.
Nous ne sommes pas champions du monde, mais on se débrouille pas mal. La France est le leader incontesté avec 123 jours de grève pour 1.000 travailleurs. Elle est suivie par le Danemark avec 118, le Canada complète le podium avec 87 jours. La Belgique? 4e: avec 79 jours pour 1.000 employés. La moyenne entre 2006 et 2015 était même « seulement » de 71 jours pour 1.000 travailleurs. Tous ces chiffres proviennent de l’Insitut allemand Wirtschaft (IW) de Cologne.
Reste que la grève fait partie de la vie de tous les Belges ou presque. Sur la route du boulot, de l’école ou de l’aéroport, tous ont connu ses conséquences. En ce sens, le service minimum peut-être vu comme une grande victoire par le gouvernement Michel de droite. Cela a toujours été impossible à réaliser en compagnie des socialistes dans les coalitions précédentes. Mais cette fois, il figurait bien au programme de l’accord gouvernemental.
Ils auront toutefois dû attendre quatre pour transformer cette volonté en réalité. Concrètement, le service minimum signifie que les travailleurs devront prévenir 72 heures à l’avance s’ils partent en grève. De cette manière, la SNCB et Infrabel pour pouvoir établir un horaire et voir quel train peut rouler ou pas. En se concentrant sur les principales lignes de trains, et, si possible, aux heures de pointe.

Un petit groupe peut prendre en otage le reste
Ce dossier reste toutefois très sensible au sein même du gouvernement. Le CD&V et certainement le MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) ne veulent pas porter atteinte au droit de manifester. Ce que continuent de penser la plupart des syndicats. Mais le gouvernement a des contre-arguments: le droit de grève est maintenant interprété de manière très large en Belgique: un tout petit groupe (au sein même d’un syndicat) peut bloquer tout le pays. Les réseaux de transport ont à cet égard un immense pouvoir de contrainte. Quelques centaines de chauffeurs influent sur des centaines de milliers de personnes. Ce n’est pas si courant que ça en Europe, voire rare.
En Allemagne, par exemple, le droit de faire grève est plus strict et doit rencontrer plusieurs conditions comme la proportionnalité, l’ordre social ou la loyauté. Notons toutefois que là-bas, les syndicats font partie intégrante des prises de décision au sein d’une entreprise. On parle d’ailleurs plus d’une cogestion. En Italie, les transports publics sont un des 15 secteurs qui doivent garantir un service minimum. Ces grèves peuvent en outre durer 24 heures et des trains et des bus sont garantis aux heures de pointe.
C’est, bien sûr, aussi une réalité chez nous concernant les services de police, les hôpitaux et pour les stations-essence. L’ambition du gouvernement était donc d’agrandir ce service minimum aux transports publics. En tout cas à la SNCB qui dépend de ses compétences. Pour tous les travailleurs, il s’agit, en principe, d’une petite révolution.
La question est de savoir si cela va marcher? En principe, si un conducteur annonce qu’il veut rouler mais qu’il ne travaille pas, il sera sanctionné lourdement. Les arrêts maladie durant les jours de grève, c’est aussi terminé. Bellot (MR) et De Block (Open VLD) sont coéquipiers sur ce dossier. Reste que pour connaître l’efficacité du service minimum, il faudra tout simplement le tester. Rendez-vous donc à la prochaine grève.